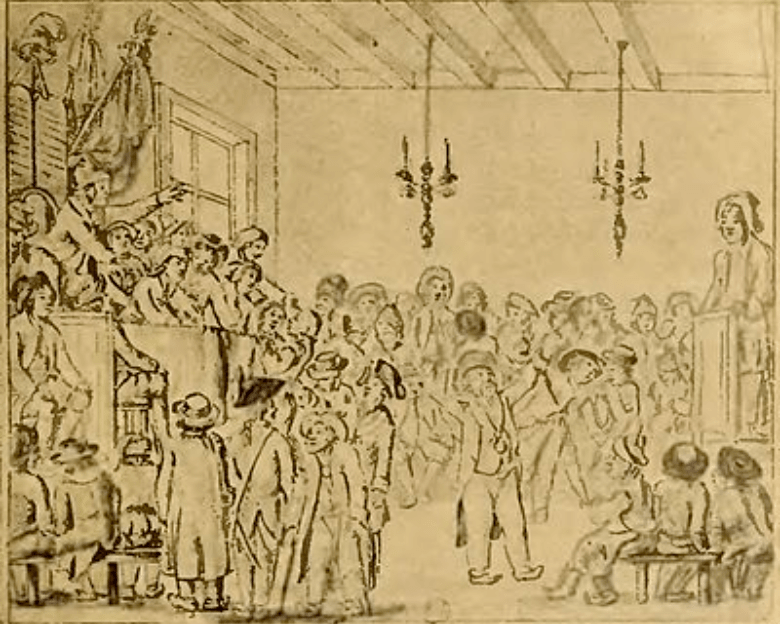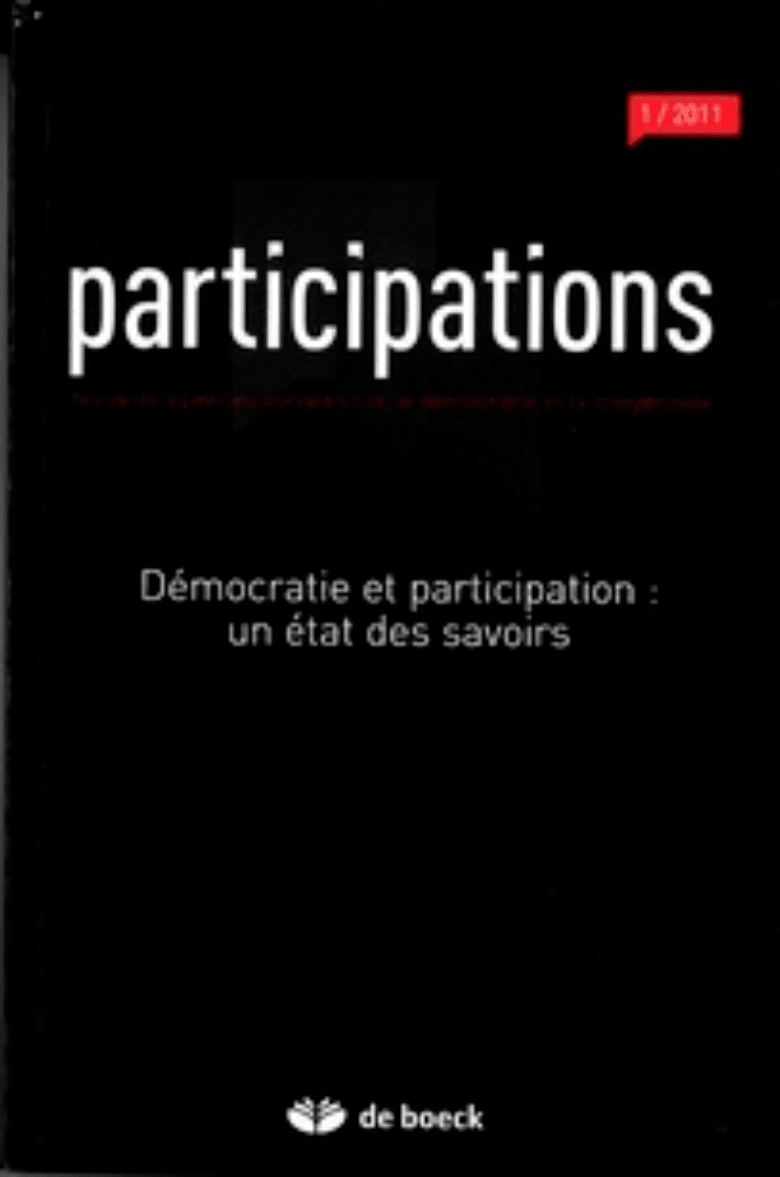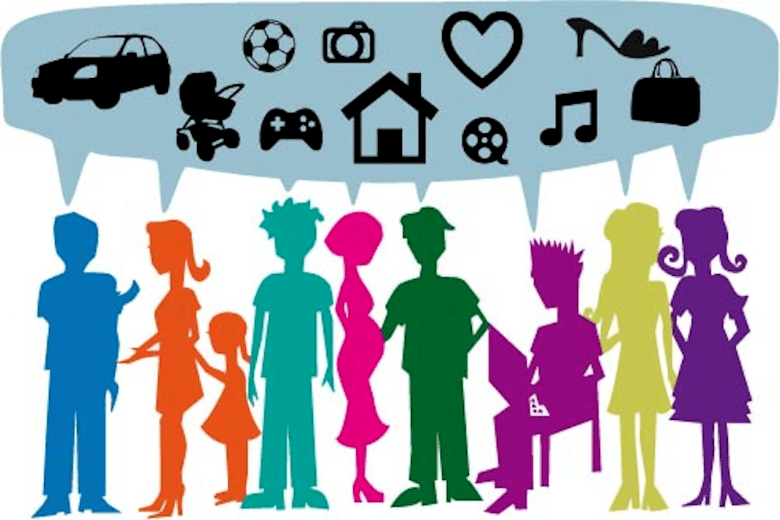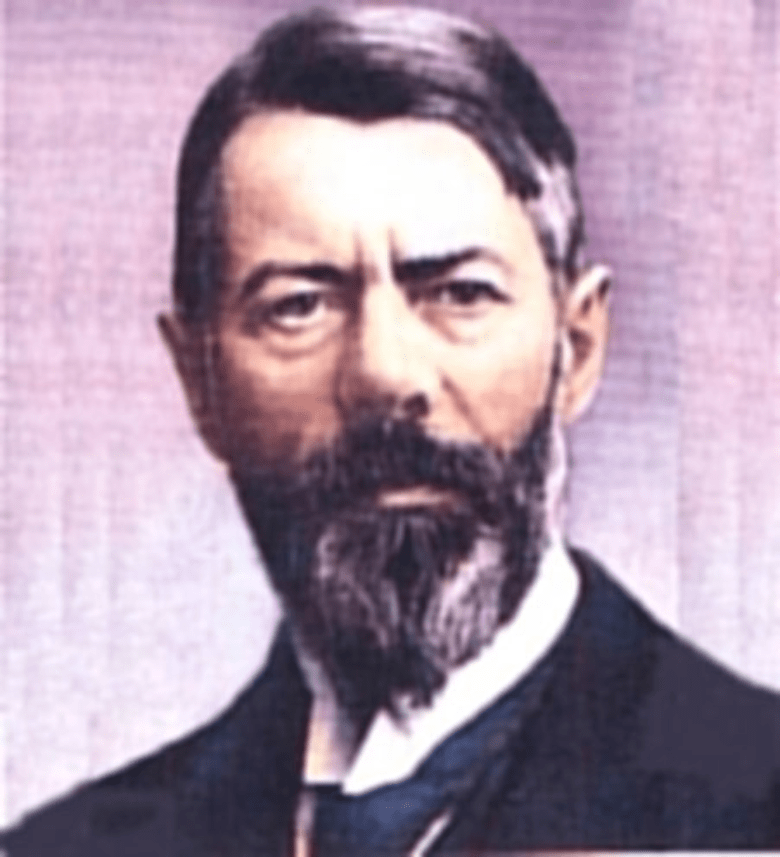 © Photo : Référence électronique
Michael Löwy, « Le concept d’affinité élective chez Max Weber », Archives de sciences sociales des religions [En ligne], 127 | juillet - septembre 2004, mis en ligne le 25 juin 2007, consulté le 03 février 2021. URL : http://journals.openedition.org/assr/1055 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.1055
© Photo : Référence électronique
Michael Löwy, « Le concept d’affinité élective chez Max Weber », Archives de sciences sociales des religions [En ligne], 127 | juillet - septembre 2004, mis en ligne le 25 juin 2007, consulté le 03 février 2021. URL : http://journals.openedition.org/assr/1055 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.1055
Le concept d’affinité élective chez Max Weber
Michael Löwy
Le concept d’affinité élective chez Max Weber
Rares sont les chercheurs en sociologie des religions qui n’ont pas, en commentant les écrits de Weber, et en particulier L’Éthique Protestante, constaté l’utilisation du terme « affinité élective ». Mais, étrangement, ce terme n’a pas suscité d’études, discussions ou débats ; on ne trouve même pas un repérage systématique des passages où l’expression est présente. Et encore moins une analyse un peu plus systématique de sa signification méthodologique. Ces notes sont une première tentative, encore très partielle et inachevée, de combler cette lacune1. Le terme affinité élective (Wahlverwandtschaft) a une longue histoire qui est bien antérieure aux écrits de Weber. Essayons de reconstituer brièvement cet itinéraire complexe, pour pouvoir capter toute la richesse de significations qu’il a accumulée au cours de son étrange périple culturel, qui va de l’alchimie à la littérature romantique, et de celle-ci aux sciences sociales.
1 Il existe un essai de Richard Herbert HOWE, « Max Weber’s Elective Affinities. Sociology within the bounds of pure reason », American Journal of sociology, n o 84, 1978, qui contient des informations intéressantes sur les origines du terme, mais la définition qu’il propose – l’affinité élective comme « une idée au sens kantien » – n’est pas très pertinente. En outre, il semble vouloir la réduire à une « affinité élective entre mots », en fonction de « l’intersection de leurs significations », ce qui en limite considérablement la portée. (Ibid. pp. 366 ; 382).