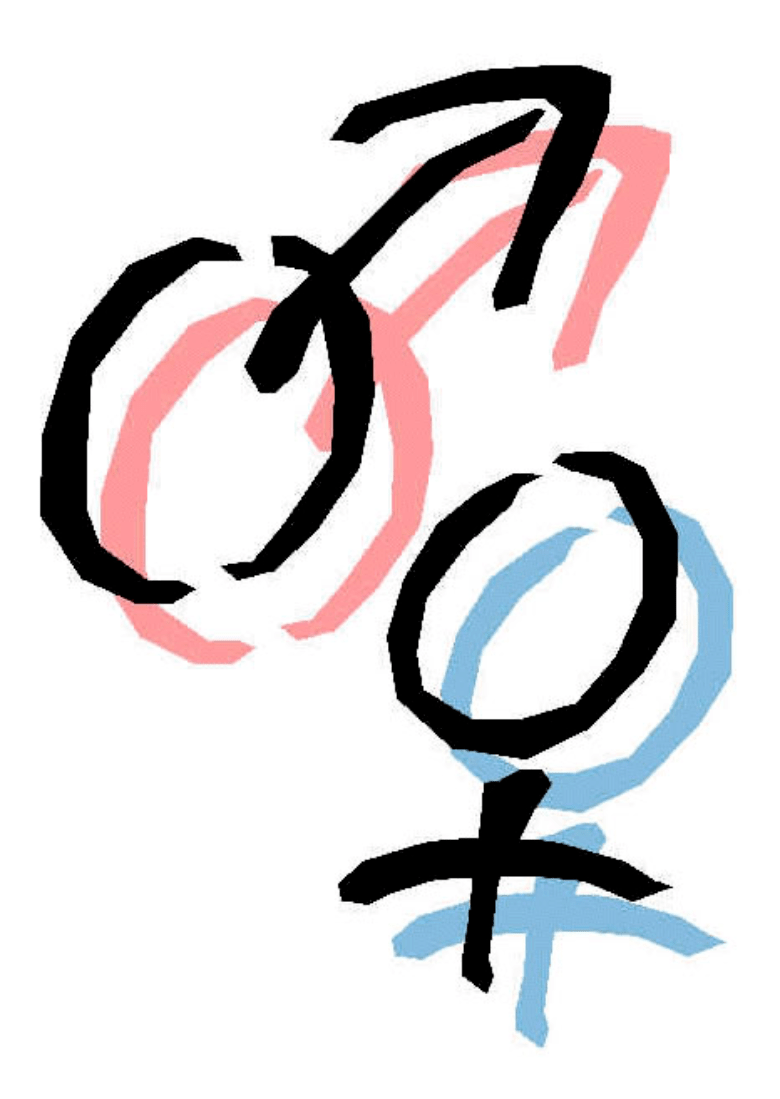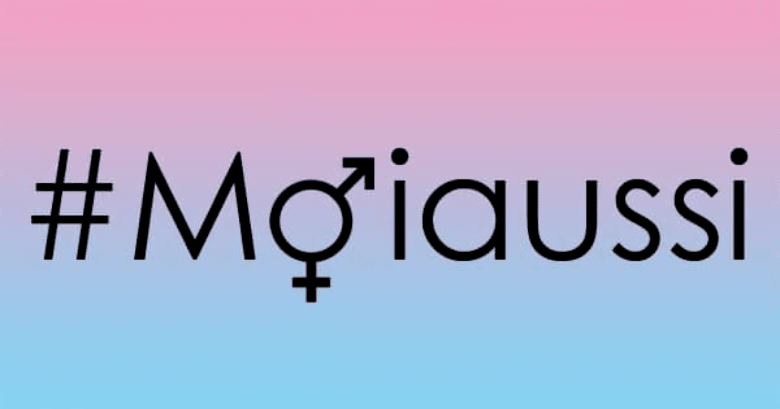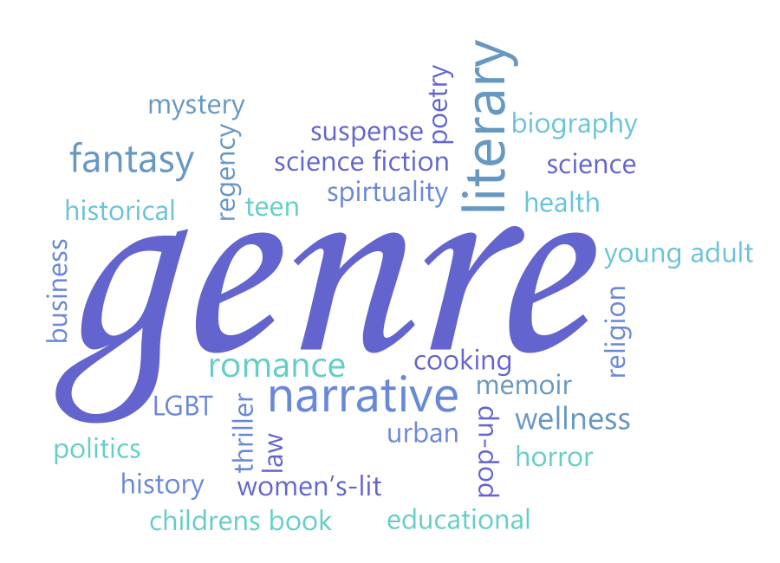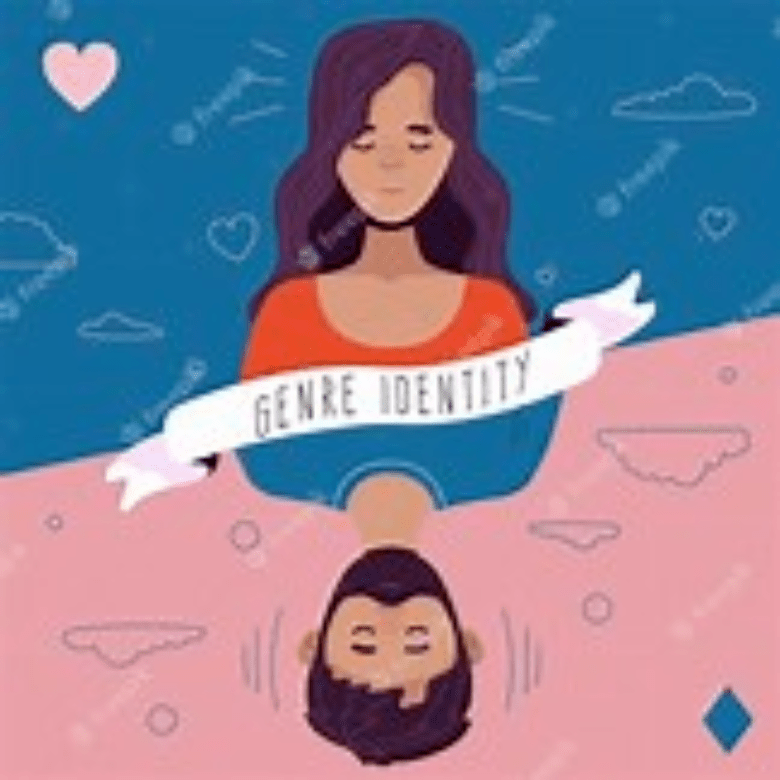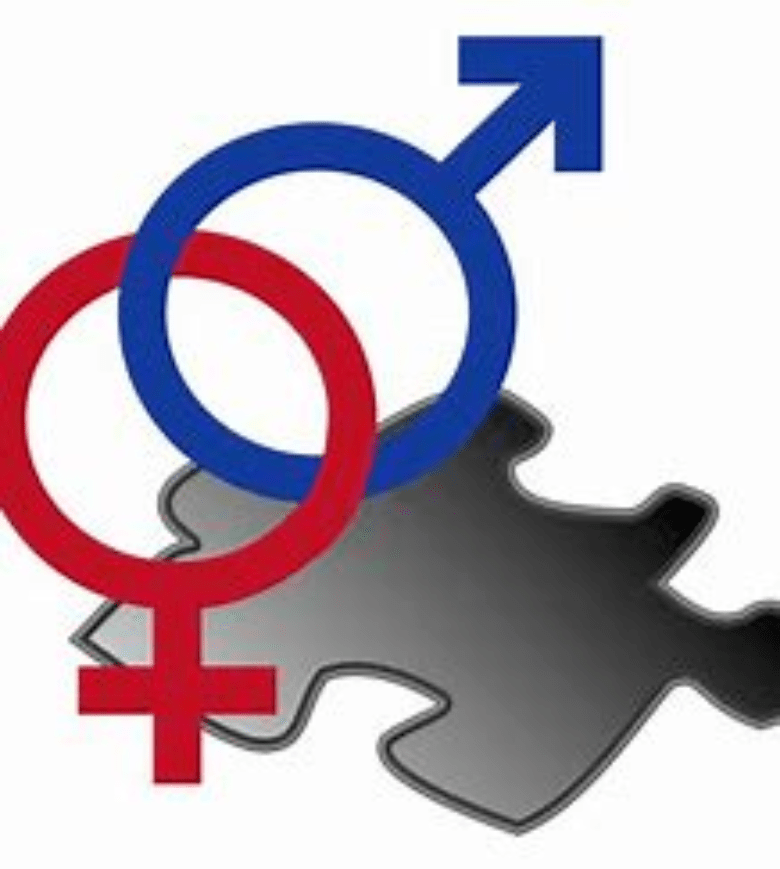Femmes au foyer et fières de l’être : féministes ou « réac » ?
Farah Dubois-Shaik

Farah Dubois-Shaik, Université de Liège
Récemment les réseaux sociaux ont mis en avant la notion de « tradwives » femmes traditionnelles en français, expression aussi apparue dans la presse anglo-saxonne.
Elle désigne des femmes qui choisissent, malgré leur(s) diplôme(s), de renoncer à leur emploi et de rester au foyer.
En réifiant ces comportements et en les assimilant à une idéologie anti-moderniste (retour à la tradition) et anti-féministe (contre la libération de la femme), une analyse trop hâtive risque de considérer ces comportements comme autant d’actes étranges et irrationnels dictés par une soumission automatique aux hommes.
Or, certains d’entre eux ne peuvent-ils être motivés par des choix complètement rationnels et motivés par une autre conception féministe de la vie ?
Un voile de suspicion
La presse qui traite de ces nouveaux modes de vie adopte jusqu’ici une perspective critique, visant à dévoiler les motifs – a priori irrationnels – de ces femmes, leurs souffrances, et la signification rétrograde de leur comportement.
Le phénomène est présenté comme un mouvement anti-féministe, voire même d’extrême droite, valorisant le retour au foyer de fashionistas dévouées à la lessive, à l’époussetage et à la cuisine dans le seul but de plaire à leurs maris.
Les réseaux sociaux favorisent la visibilité de cette attitude en offrant un espace de témoignage pour les tradwives blogueuses rassemblées sous la bannière du hashtag.
Si anachroniques qu’ils puissent paraître, ces comportements s’inscrivent-ils tous dans un seul et même courant visant à détricoter les acquis d’une société moderne enfin libérée ? Le discours médiatique critique n’oublie-t-il pas de comprendre certaines raisons pouvant présider à des comportements hétérogènes ?
Une réaction générationnelle
Les femmes d’aujourd’hui sont les héritières d’un réel mouvement de libération sexuelle et professionnelle opéré entre les années 1970 et 1990. Elles connaissent depuis lors un meilleur accès aux emplois jusqu’alors réservés aux hommes : avocat·e·s, médecins, journalistes, architectes, ingénieur·e·s, élu·e·s politiques, professeur·e·s d’université, électricien·ne·s, fermières etc.
Les femmes des années 1970 et 1990 ont connu la croissance et la mutation des modèles familiaux. Plusieurs recherches prenant en exemple des femmes italiennes et suédoises ont ainsi montré comment certaines privilégiaient leur carrière à la maternité, par désir ou nécessité.
Et si ces deux générations post-baby-boomers constituent un modèle pour les femmes d’aujourd’hui, on observe que certaines d’entre elles donnent désormais la priorité à leur vie familiale. S’opposent-elles par-là aux générations précédentes qui ont libéré leur accès au travail ?
Aujourd’hui, les configurations conjugales et du couple ont évolué, avec nombre de couples recomposés et de familles mono-parentales. Mais contrairement a ce qu’on pourrait croire, ces changements de modèles familiaux et l’accès libéré au monde du travail n’ont pas diminué l’importance primaire que les femmes (et les hommes) accordent à la famille dans leurs priorités de vie, comme le montrent des études européennes.
D’ailleurs, on peut supposer que le choix de rester au foyer – posé par des femmes mais aussi par des hommes – est négocié au sein du couple, où la domination du « breadwinner » n’est plus systématique, comme cela a davantage pu être le cas par le passé (l’homme qui soutenait la famille en termes économiques).
Des carrières vécues différemment
Les périodes d’engagements professionnels sont également plus courtes : on ne parle plus de carrière continue et linéaire et les contrats de travail sont de plus en plus flexibles, voire précaires.
Ces durées entre deux contrats de travail ou durant une reconversion professionnelle peuvent aussi être des périodes au foyer que certaines femmes (et hommes) peuvent vivre de manières différentes ; comme une période de reconstruction identitaire ou un « turning point » (un moment décisif dans la vie de basculement vers autre chose) autant pour la vie professionnelle que personnelle.
De plus, les femmes ont peut-être un maigre et rare privilège par rapport à leurs homologues masculins : leurs congés parentaux ne subissent pas la pression des stéréotypes masculins qui continuent de persister. Prendre un congé parental ou de paternité reste encore un tabou dans un monde du travail vorace.
Le refus de participer à des organisations voraces
Aujourd’hui, les étudiantes sont majoritaires sur les bancs des universités européennes. Mais une fois dans l’emploi, on observe la permanence d’un plafond de verre et d’un « sol gluant ». Cela signifie que de nombreuses femmes ne parviennent pas à gravir les échelons hiérarchiques et restent figées dans des statuts précaires et dans des emplois peu valorisés.
Elles peuvent donc accéder aux métiers hautement qualifiés, mais sont souvent pénalisées en termes de promotion, de statut et de responsabilité. Nombreuses sont celles qui font face à divers obstacles en matière d’intégration dans leurs unités de travail et à une surcharge de travail accrue.
Malgré les progrès forgés par les générations précédentes, le monde de travail reste encore fortement marqué par une logique masculine. Et nombre d’hommes souffrent aussi de cette surcharge de travail à l’heure où la technologie et le télétravail brouillent la frontière entre vie privée et vie professionnelle.
Les travailleurs sont désormais tenus d’être joignables en tout temps et en tout lieu, de répondre en temps réel aux accélérations des projets et aux ordres des clients et des actionnaires.
La mobilité est aussi devenue une norme exigeante.
L’expérience du travail peut alors entrer en tension avec diverses expériences familiales et personnelles (repos, jeunes enfants, parents âgés, proches souffrants, temps libre, etc.) et mener à des souffrances telles que le burn-out, brown out (quand le travail perd son sens) etc. D’autant plus lorsque règnent sans partage les normes capitalistes de productivité et d’omniprésence.
Une manière de dire non aux normes socio-économiques dominantes
Si de plus en plus de femmes reviennent – temporairement au moins – au foyer, ne peut-on y voir un signe d’insatisfaction et de défection face aux normes socio-économiques dominantes, où la vie privée ne doit être qu’une variable d’ajustement ?
Par exemple, certaines femmes ayant quitté le monde universitaire indiquent avoir choisi de fuir des institutions voraces qui exigent un engagement exclusif au travail, empiétant sur la vie de couple et de famille, le temps de loisirs et de qualité.
Là où des emplois à temps partiels (réels et pas fictifs) sont accessibles pour les femmes des classes moyennes et supérieures, une conciliation satisfaisante semble envisageable.
Ceci invite à considérer le retour au foyer comme un privilège réservé à celles qui peuvent se l’offrir… Notons par ailleurs que certains hommes opèrent des choix similaires, mais sans les exposer sur le web.
« Exit » et « Care » : deux attitudes critiques ?
Que certaines femmes – et certains hommes – accordent la priorité à leur vie de famille et au « care » constitue-t-il systématiquement un frein à leur épanouissement personnel et à leur pouvoir d’achat ? Certains de ces choix ne peuvent-ils être appréhendés comme une critique de la modernité avancée ?
Nous supposons qu’il existe une diversité d’expériences qui s’accommodent mal des stéréotypes et des hashtag réifiants de « tradwives ». Pour éviter de tomber dans le piège de la victimisation de ces femmes, pourquoi ne pas postuler que leurs choix sont le plus souvent collectifs et proposés par des individus intelligent·e·s et stratégiques ?
Certaines femmes posent ce choix pour une variété de raisons. Certaines pour sortir (exit) d’un monde du travail trop vorace qui les obligerait à sacrifier leur vie privée et parentalité. D’autres pour favoriser une réorientation professionnelle ou individuelle, permettant de passer aussi plus de temps au foyer.
Mais ces choix politiques restent associés à la fois à un privilège probablement réservé à la classe moyenne ou supérieure, en nécessitant des revenus alternatifs (travail à temps partiel, télétravail, épargne, ou revenu partagé en couple), et à un monde de travail inadapté aux besoins familiaux et personnels. Des études scientifiques qui associeraient ces dimensions pour creuser la question de ce choix du retour au foyer sont nécessaires.
La prudence invite à ne pas généraliser les craintes relatives à ces choix de vie, tout en essayant de saisir la dimension critique des choix étudiés. En outre, ne poser le regard que sur les femmes sortant de la vie professionnelle constitue une problématisation genrée, ce qui va à l’encontre d’un regard féministe et critique.< !—>
![]() http://theconversation.com/republishing-guidelines —>
http://theconversation.com/republishing-guidelines —>
Farah Dubois-Shaik, Sociologue du genre, de l’éducation et de la diversité, Université de Liège
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.